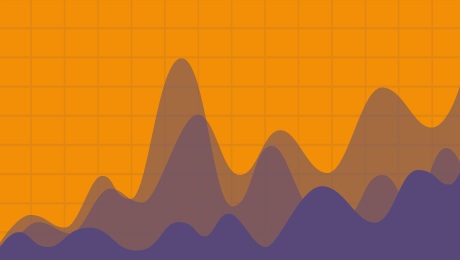Le choc, d’abord financier, est visible à la seconde près sur les obligations d’État et la valeur de l’euro. Mais ses effets se propagent, par canaux bien identifiés, aux taux pratiqués par les banques, à l’investissement des entreprises et, plus durablement, à la trajectoire du PIB. L’instabilité gouvernementale, loin d’être confinée au Salon doré et aux couloirs de Matignon, s’étend à toute l’économie.
La hausse des taux souverains français (et pourquoi elle survient)
Dans les heures qui ont suivi l’annonce de la démission de Sébastien Lecornu,Premier ministre « éphémère », les investisseurs ont demandé une rémunération supplémentaire pour détenir de la dette française.
Concrètement, le rendement exigé des obligations d’État françaises à 10 ans s’est hissé autour de 3,60 %, avec un écart (dit spread) avec l’Allemagne porté au plus haut depuis fin 2024. Ce spread mesure la prime de risque spécifique associée à la France et constitue le thermomètre immédiat de la défiance. Ces tensions prolongent une séquence déjà défavorable depuis la dégradation de la note souveraine un cran plus bas mi-septembre, qui avait rapproché le niveau de rendement français de celui de l’Italie. Elles s’inscrivent enfin dans un contexte international où la « discrimination » entre signatures publiques très endettées s’est accrue en 2025, ce qui rend la France plus sensible aux variations d’humeur du marché.
Pourquoi les taux montent ?
Pourquoi ces taux montent-ils ? La chaîne causale est classique.
Premièrement, l’instabilité gouvernementale accroît l’incertitude budgétaire, en rendant plus difficile l’adoption de trajectoires crédibles de déficit et de dette. Cette incertitude rejaillit immédiatement sur la prime de risque exigée par les investisseurs, qui craignent un défaut de remboursement. Deuxièmement, la révision récente de la qualité de crédit souveraine par une grande agence formalise ce diagnostic et sert de point d’ancrage aux gérants obligataires, qui réévaluent leurs limites d’exposition. Troisièmement, des dynamiques d’auto-alimentation peuvent apparaître : si l’État français emprunte plus cher, donc aura plus de mal à rembourser, ce qui le rend moins crédible, et donc augmente encore son coût de financement.
Les conséquences sur les taux dans toute l’économie française
Quand les taux d’État montent, c’est toute la courbe de référence de l’économie qui se décale.
Les banques se refinancent plus cher sur les marchés et répercutent progressivement ces coûts sur les entreprises et les ménages, via les taux des nouveaux crédits. La transmission n’est ni instantanée ni intégrale : elle dépend de la structure de financement des banques, de la concurrence et des contraintes réglementaires.
En 2025, les statistiques monétaires montraient une stabilisation des taux des nouveaux prêts immobiliers un peu au-dessus de 3 %, et des crédits à la consommation autour de 6–6,5 %. Un épisode de stress souverain pourrait interrompre cette accalmie, en incitant les prêteurs à durcir l’accès au crédit, surtout pour les profils risqués.
Ce canal souverain banques–crédit a deux implications macroéconomiques immédiates. D’une part, il pèse sur l’investissement des entreprises, particulièrement dans les secteurs intensifs en capital et dépendants du financement bancaire. D’autre part, il ralentit la reprise de l’immobilier résidentiel, où la demande est sensible aux taux.
Effets de long terme de l’instabilité politique sur la croissance
Au-delà de la surtaxe immédiate sur les taux, que dit la recherche sur la croissance ?
Les travaux fondateurs mettent en évidence un lien robuste entre instabilité politique et moindre croissance du PIB par tête. L’idée est simple : lorsque la probabilité de renversement de gouvernement est élevée, les agents privés reportent des décisions irréversibles, l’investissement productif se contracte et la productivité pâtit d’une moindre réallocation des facteurs (par exemple, des entreprises plus efficaces ou innovantes ne voient pas le jour).
Plus généralement, les chocs d’incertitude documentés par la macroéconomie produisent des baisses rapides mais significatives d’activité et d’emploi, via un « effet pause » sur l’embauche et les projets d’expansion.
Transposé au cas français, un régime prolongé d’instabilité institutionnelle agirait comme un frein de fond sur le PIB.
À l’horizon de quelques années, les mécanismes décrits ci-dessus se combinent à l’étroitesse de la marge de manœuvre budgétaire pour peser sur la capacité de l’économie à amortir les chocs et à soutenir la demande sans dégrader encore les finances publiques.
L’Histoire récente rappelle cependant que ces effets ne sont pas inéluctables : la clarification rapide du cadre budgétaire et institutionnel tend à réduire les primes de risque, à réactiver l’investissement et à limiter les pertes de production par rapport à un scénario d’incertitude persistante. Autrement dit, il vaut parfois mieux prendre une (mauvaise) direction que de rester sur place.