Origines médiévales, quand l’impôt était exceptionnel
Au Moyen Âge, l’impôt n’était pas permanent comme aujourd’hui, mais levé de façon exceptionnelle, par exemple pour financer les guerres. Parmi les prélèvements les plus célèbres : la gabelle, un impôt sur le sel instauré au XIIIe siècle sous Philippe Le Bel. Cet impôt, particulièrement impopulaire, obligeait chaque foyer à acheter une quantité minimale de sel au prix fixé par le royaume.
Autre impôt : les « tailles », prélevées sur le Tiers-État (toutes les personnes n’appartenant pas au clergé et à la noblesse).
Comme le souligne l’historien Alain Guéry dans « La fiscalité royale française aux XVIIe et XVIIIe siècles » (1978) : « Les impôts pesaient essentiellement sur ceux qui avaient le moins de moyens de les payer. »
Lors de la guerre de Cent Ans (1337-1453), Charles VII établit en 1439 la taille royale permanente pour financer une armée régulière. Pour la première fois, l’impôt devient permanent.
Révolution française et la réforme fiscale
« L’impôt doit être consenti librement par tous les citoyens ou leurs représentants » – Cette idée, formulée dès le XVIIIe siècle, est un principe révolutionnaire fondamental. En effet, l’injustice fiscale a été l’une des causes majeures de la Révolution française et dans les cahiers de doléances de 1789, la réforme de l’impôt figure parmi les revendications principales.
La nuit du 4 août 1789 voit l’abolition des privilèges, c’est la fin des exemptions fiscales de la noblesse et du clergé. L’Assemblée constituante pose alors plusieurs principes novateurs qui perdurent aujourd’hui :
- L’égalité devant l’impôt : tous les citoyens, sans distinction de rang, doivent contribuer aux charges publiques.
- Le consentement à l’impôt par les représentants du peuple.
- La proportionnalité de l’impôt aux facultés contributives.
La période révolutionnaire voit la création de la contribution foncière, de la contribution mobilière et de la patente (ancêtre de la taxe professionnelle), remplaçant les anciens impôts d’Ancien Régime.
La fiscalité moderne
Le XXe siècle marque l’avènement de notre système fiscal contemporain. L’impôt sur le revenu, est créé en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. Pour la première fois, l’impôt prend en compte la situation personnelle et familiale du contribuable et introduit une progressivité (taux qui augmente en fonction du revenu).
En 1954, sous la IVe République, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est inventée par Maurice Lauré, inspecteur des finances. Cette innovation fiscale française sera ensuite adoptée par plus de 150 pays dans le monde, devenant l’impôt le plus répandu au niveau international.
La seconde moitié du XXe siècle voit également l’émergence d’un impôt de solidarité spécifique pour les contribuables ayant un patrimoine important. C’est la création en 1982 de l’Impôt sur les Grandes Fortunes (IGF), qui deviendra l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) en 1989, puis l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) en 2018.
Aujourd’hui, le système fiscal français repose sur un équilibre entre :
- Les impôts directs payés par les contribuables (impôt sur le revenu, impôts locaux).
- Les impôts indirects, inclus dans le prix des biens et services (TVA notamment).
- Les cotisations sociales prélevées sur les salaires, finançant la protection sociale.
Notre système fiscal est le résultat de choix de société et d’un certain consensus entre les partenaires sociaux (syndicats, patrons…), l’autorité publique et les citoyens.



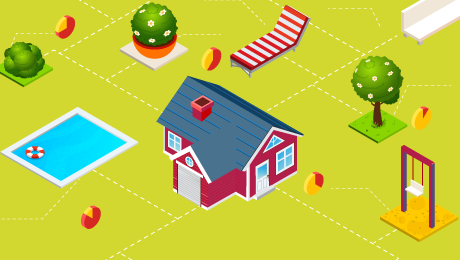

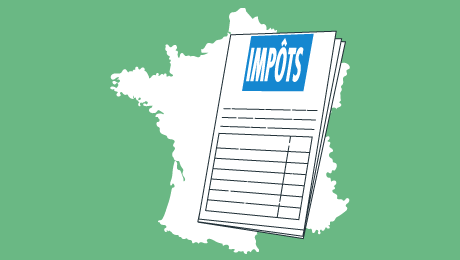
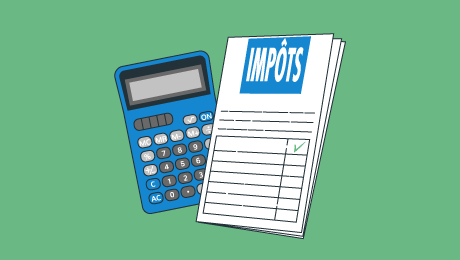



Commenter