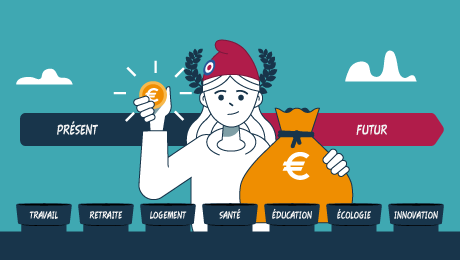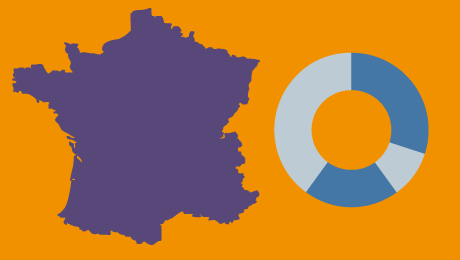Dans son œuvre, Antonin mène une réflexion sur les problématiques des dépenses publiques, et aborde des enjeux sociaux, territoriaux, régaliens, écologiques et économiques, permettant d’acquérir une vue d’ensemble du thème, données et graphiques à l’appui.
Le traitement des enjeux économiques et les partis pris de l’essai reflète la pensée de l’auteur, et non celle de La Finance Pour Tous, qui joue le rôle de relais d’un travail riche et densément documenté.
Cette semaine, Antonin traite d’un sujet qui nous tient particulièrement à cœur : l’éducation
Le système éducatif français traverse une crise structurelle, aggravée par des décisions budgétaires successives qui affaiblissent son efficacité.
D’abord, le manque d’enseignants fragilise le fonctionnement des établissements. Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé la suppression de 4 000 postes en 2025 (dont 79% concerne le premier degré public), malgré un déficit de 3 150 postes vacants en juillet 2024 (92% dans le public), notamment pour enseigner les mathématiques, sciences et langues. En 2024, 2023 et 2022, il s’agissait de 2500, 1500 et 2000 postes supprimés. Ces suppressions s’expliquent par une diminution de 97 000 élèves en 2025. Cependant, cette réduction est perçue comme une mesure à court terme, risquant de pénaliser le système éducatif lors de futures hausses démographiques. La suppression de postes dans un contexte de postes vacants réduit la marge de manœuvre pour diminuer les effectifs par classe et exacerbe les difficultés dans les zones rurales et prioritaires, déjà confrontées à un manque de personnel qualifié.
En parallèle, la profession perd en attractivité. Entre 2015 et 2023, la part des enseignants non titulaires a bondi de 6 % à 9 %. Les conditions de travail et les salaires jouent un rôle clé : un enseignant français gagne 10 % à 15 % de moins que la moyenne OCDE, ce qui décourage les nouvelles vocations.
Dans l’enseignement supérieur, le constat est similaire. Depuis 2010, le nombre d’étudiants a augmenté de 50 %, mais le budget universitaire n’a pas suivi. En 2023, la dépense par étudiant a chuté de 3 %, provoquant une saturation des infrastructures et un manque de ressources pédagogiques. Le ratio étudiants/enseignants est passé de 20 à 24 en une décennie, dégradant les conditions d’apprentissage.
Les difficultés financières touchent aussi les étudiants ; 30 % d’entre eux déclarent être en difficulté, notamment à cause du coût du logement et du manque de bourses adaptées. L’effet de seuil empêche certains étudiants des classes moyennes d’accéder aux aides, creusant les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur.
L’alternative pour certains est l’apprentissage, dont la popularité explose. Entre 2015 et 2020, le nombre de contrats d’apprentissage a bondi de 53 %, avec une hausse de +220 % des licences et +136 % des masters en apprentissage. Si cette voie est efficace en matière d’insertion professionnelle (85 % des diplômés en master apprentissage trouvent un emploi en 6 mois), elle illustre aussi une tendance préoccupante : l’État investit davantage dans la professionnalisation immédiate que dans la formation universitaire classique.
Enfin, les inégalités territoriales restent criantes. Certaines académies affichent des taux de réussite inférieurs de 10 points à la moyenne nationale, tandis que les établissements ruraux et défavorisés manquent cruellement d’infrastructures et d’enseignants qualifiés. En 2024, 70 % des élèves en REP+ et 56 % des élèves en REP sont issus de milieux défavorisés, illustrant la concentration des difficultés scolaires.
Face à ces limites du système public, le privé progresse. En 2024, 13,97 % des élèves du primaire, 21,36 % du secondaire et 26,6 % du supérieur sont scolarisés dans des établissements privés sous contrat. Le phénomène s’accélère depuis 2018 (+5,2 points), en particulier dans les grandes villes et les secteurs porteurs comme le numérique et le commerce.
Enfin, l’investissement dans la recherche est à la traîne. En 2023, la France consacre 2,2 % du PIB à la R&D, contre 3 % en moyenne en Europe, freinant son innovation scientifique et technologique.
Nous félicitons encore Antonin Batteur pour cette œuvre.
La semaine prochaine, nous vous présenterons la réflexion d’Antonin au sujet du logement.
Vous pouvez télécharger l’intégralité de l’essai en pdf et nous continuons à vous proposer chaque semaine les meilleurs extraits de son analyse.


![Enjeux des dépenses publiques [3/17] : l'éducation](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/07/grand_prix3_800-tt-width-800-height-2629-fill-0-crop-0-bgcolor-eeeeee.png)
![Enjeux des dépenses publiques [1/17] : défis du système de santé en France](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/07/grand_prix1_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [2/17] : vieillissement et migration, un équilibre menacé](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/07/grand_prix2_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [4/17] : la crise du logement, une pénurie chronique](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/08/grand_prix4_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)