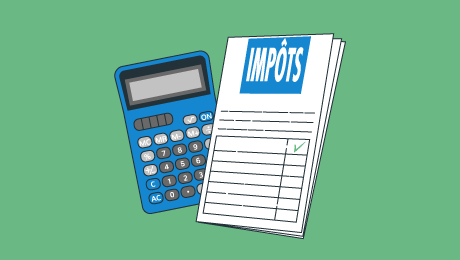Antonin traite des enjeux sociaux, territoriaux, régaliens, écologiques et économiques, qui permette d’acquérir une vue d’ensemble des enjeux des dépenses publiques.
Le traitement des enjeux économiques et les partis pris de l’essai reflète la pensée de l’auteur, et non celle de La Finance Pour Tous, qui joue le rôle de relais d’un travail riche et densément documenté.
Une fiscalité en mutation entre compétitivité et contraintes
Le système fiscal français a évolué sous la double contrainte de la compétitivité économique et du respect des règles européennes. Depuis les années 2000, l’objectif a été d’aligner la fiscalité sur celle de ses voisins. L’impôt sur les sociétés, limitant la fuite des capitaux et renforçant l’a réactivité des entreprises.
Côtés ménages, la suppression de l’ISF en 2018, remplacée par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), a allégé la fiscalité des patrimoines. En parallèle, la mise en place du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30 % a harmonisé la taxation des dividendes et des plus-values.
La fiscalité écologique s’est aussi développée avec la contribution Contribution Climat-Énergie en 2014 et la montée de la taxe carbone, provoquant des tensions, notamment lors de la crise des gilets jaunes en 2018.
L’Europe a franchi une étape majeure vers l’harmonisation fiscale en adoptant, en décembre 2022, un impôt minimum de 15 % sur les bénéfices des multinationales. Cette décision, découlant d’un accord élaboré par l’OCDE en 2021 et approuvé par 137 États, vise à freiner la compétition fiscale entre pays et à garantir que les grandes entreprises paient leur juste part d’impôts, indépendamment de leur localisation. Cette mesure s’applique aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 750 millions d’euros et devrait générer environ 150 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires par an au niveau mondial.
Parallèlement, face à l’essor du numérique et à l’optimisation fiscale pratiquée par les géants du secteur, la France a instauré dès 2019 une taxe sur les services numériques, souvent appelée «taxe GAFA». Cette taxe de 3 % s’applique aux entreprises numériques dont le chiffre d’affaires mondial dépasse 750 millions d’euros, avec au moins 25 millions d’euros générés en France. En 2020, cette taxe a rapporté 375 millions d’euros au Trésor français.
Ces initiatives reflètent une volonté accrue des États de s’adapter aux défis posés par la mondialisation et la digitalisation de l’économie, en assurant une répartition plus équitable de la charge fiscale entre les entreprises.
Merci encore à Antonin Batteur pour cette œuvre ! La semaine prochaine, nous traiterons des enjeux de l’armée.
Vous pouvez télécharger l’intégralité de l’essai en pdf et nous continuons à vous proposer chaque semaine les meilleurs extraits de son analyse.


![Enjeux des dépenses publiques [9/17] : une fiscalité en mutation entre compétitivité et contraintes Enjeux des dépenses publiques [9/17] : une fiscalité en mutation entre compétitivité et contraintes](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/09/grand_prix_9_800-tt-width-800-height-2099-fill-0-crop-0-bgcolor-eeeeee.png)
![Enjeux des dépenses publiques [1/17] : défis du système de santé en France](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/07/grand_prix1_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [2/17] : vieillissement et migration, un équilibre menacé](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/07/grand_prix2_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [3/17] : l’éducation, un investissement sacrifié ?](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/07/grand_prix3_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [4/17] : la crise du logement, une pénurie chronique](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/08/grand_prix4_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [5/17] : chômage, un mal français structurel](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/08/grand_prix5_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [6/17] : précarité et aides sociales, un système sous pression](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/08/grand_prix6_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [7/17] : inégalités et fiscalité, un système favorable aux plus aisés ?](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/08/grand_prix7_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)