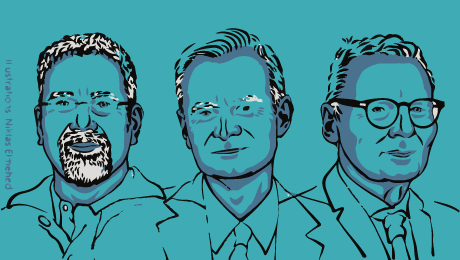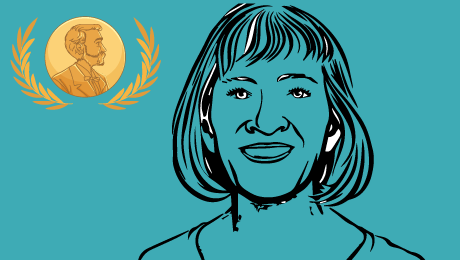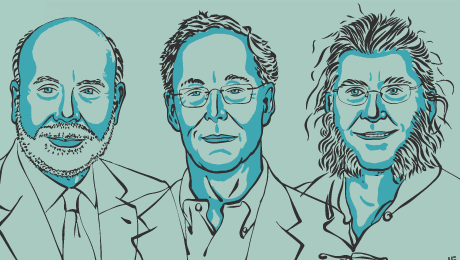Joel Mokyr : l’invention de la croissance
Joel Mokyr a profondément renouvelé notre compréhension des ressorts de la croissance moderne. Dans ses travaux, il montre que le changement technologique est un processus à la fois fragile et cumulatif, dont la dynamique dépend autant des idées que des institutions qui les portent. Dans The Lever of Riches, il souligne l’importance des macro‑inventions (machine à vapeur, imprimerie, génération d’électricité) sans lesquelles le progrès finit par s’essouffler. Mais il insiste aussi sur la diversité politique et intellectuelle européenne, et sur le rôle structurant du Siècle des Lumières.
Avec The Gifts of Athena, Mokyr distingue deux notions fondamentales : le savoir propositionnel et le savoir utile. Le savoir propositionnel est théorique, et ont trait aux lois de la nature ; le savoir utile, lui, regroupe l’ensemble des techniques, recettes et procédés qui permettent d’agir sur le monde. L’interaction de ces deux formes de connaissance, conjuguée aux institutions qui les produisent et les diffusent, a déclenché une accélération cumulative du progrès technique. À partir du XVIIIe siècle, la production de connaissances fondamentales est devenue une entreprise collective, organisée autour d’universités, de sociétés savantes et d’académies, explicitement orientée vers les applications. La force motrice du progrès ne tient donc pas seulement à l’augmentation du savoir, mais au fait que les institutions et la culture ont collaboré pour offrir un meilleur accès à cette base de connaissances.
Dans A Culture of Growth, Mokyr avance que l’Europe s’est singularisée par une conjonction rare : une unité culturelle des savants, formant une communauté transnationale où les idées circulaient librement, et une fragmentation politique intense entre États concurrents. Cette configuration a créé un mécanisme d’exutoire : aucune autorité centrale ne pouvait étouffer durablement une innovation ou une idée subversive, les penseurs pouvant se déplacer vers des juridictions plus tolérantes. C’est cette compétition entre États, alliée à une culture pan‑européenne du savoir, qui a empêché l’imposition d’une orthodoxie unique et favorisé l’expérimentation continue. À l’inverse, d’autres régions fragmentées comme l’Inde n’ont pas bénéficié d’une culture partagée du progrès, tandis qu’un grand empire unifié comme la Chine impériale a souffert d’une orthodoxie imposée par une élite conservatrice.
Philippe Aghion et Peter Howitt : la croissance par destruction créatrice
Philippe Aghion et Peter Howitt ont placé l’innovation au cœur d’une théorie moderne de la croissance inspirée de Schumpeter. Leur contribution fondatrice, A Model of Growth through Creative Destruction, reformule la croissance endogène autour de deux idées décisives. D’une part, l’obsolescence des technologies est intrinsèque au processus d’innovation : chaque progrès de qualité rend la technologie précédente obsolète. D’autre part, la croissance est discontinue, rythmée par des sauts d’innovation qui surviennent de manière aléatoire.
Dans ce cadre, les chocs technologiques ne sont pas exogènes, comme tombés du ciel, mais endogènes, fruits d’un effort de recherche et développement qui mobilise des ressources rares. Les innovations, qui abaissent les coûts de production et font progresser la productivité, sont protégées. Les droits de propriété intellectuelle jouent ici un rôle d’incitation : le brevet offre un monopole temporaire et donc une rente, mais ce pouvoir est limité par les règles de concurrence et, surtout, contesté par l’arrivée potentielle du prochain innovateur.
L’apport schumpétérien d’Aghion et Howitt est de montrer que la croissance de long terme résulte d’innovations verticales, de qualité, qui créent une double dynamique. Elle est positive d’un côté, parce que la nouvelle technologie accroît la productivité. Mais elle est aussi négative, puisqu’elle détruit les profits des producteurs en place et des emplois. Elle se retrouve au cœur de tensions économiques.
Au‑delà de la théorie, les travaux d’Aghion éclairent des débats contemporains sur la politique industrielle, l’organisation des marchés et le marché du travail. En montrant comment la concurrence, bien réglée, stimule l’innovation sans l’étouffer, ils fournissent un cadre pour penser les arbitrages entre incitations privées, diffusion des connaissances et cohésion sociale. Cette vision a été saluée par de nombreux économistes, qui y voient une boussole pour concilier accélération technologique, transition écologique et inclusion.
Le fil rouge : transformer le savoir en croissance
Ce prix Nobel d’économie 2025 met en résonance deux versants d’une même question : comment une société produit‑elle, organise‑t‑elle et diffuse‑t‑elle le savoir pour en faire de la croissance durable ?
Mokyr insiste sur la culture, les croyances, les institutions et les communautés savantes. Aghion et Howitt montrent comment, une fois ces conditions réunies, la mécanique d’innovation, soutenue par des incitations adaptées et encadrée par la concurrence, engendre une croissance de long terme par paliers successifs.
Le progrès technologique n’est donc pas un heureux hasard ; c’est une construction sociale fragile, qui suppose des institutions ouvertes et des marchés capables de récompenser l’audace entrepreneuriale sans figer la rente.


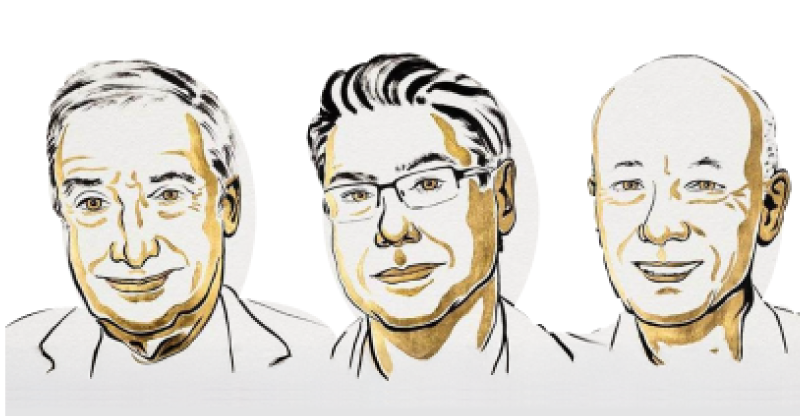



![Enjeux des dépenses publiques [13/17] : une révolution technique, un retard français ?](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/10/grand_prix_13_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)