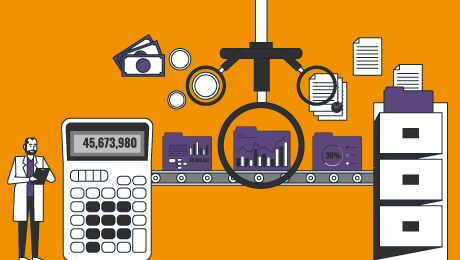Cette nouvelle dynamique, souvent qualifiée de fragmentation, privilégie désormais la sécurité des approvisionnements et les alliances politiques, au risque de remettre en cause les acquis de la mondialisation. La Direction générale du Trésor propose, dans une note publiée début novembre, une mesure de cette fragmentation.
Une reconfiguration géopolitique des échanges
Cette tendance à la fragmentation se matérialise par une modification profonde des flux commerciaux. Les données récentes mettent en évidence une intensification des échanges entre pays partageant les mêmes alliances stratégiques, au détriment des relations avec des blocs rivaux. Ce phénomène, parfois appelé friendshoring (la délocalisation chez les amis), illustre la volonté des puissances publiques d’orienter le commerce vers des partenaires jugés plus sûrs, utilisant aussi bien des incitations positives, comme des accords commerciaux ciblés, que des sanctions ou des barrières tarifaires.
Dynamique des échanges
Considérons deux blocs, le G7+ (composé des grandes économies occidentales) et les BRICS+ (composés des grandes économies du « Sud global »).
Pour chaque bloc, on peut mesurer l’évolution des importations entre les pays du bloc (intra-blocs), et des importations depuis les pays du bloc rival (inter-blocs).
Entre 2010 et 2024, les importations des pays du G7+ ont augmenté d’environ 60 % depuis d’autres pays du G7+ et diminué de 40 % depuis les pays des BRICS+ Russie. Autrement dit, le commerce au sein du bloc a explosé, tandis que le commerce avec l’autre bloc a chuté. On peut observer une dynamique similaire pour le bloc des BRICS+.
Ces résultats se confirment si on se concentre sur d’autres définitions des deux blocs : alliés des États-Unis vs alliés de la Russie, ou bien soutiens de l’Ukraine vs soutiens de la Russie.
Si cette stratégie vise à réduire les dépendances envers des pays jugés hostiles, elle n’est pas sans conséquence sur la structure même de l’économie mondiale. La logique de blocs, opposant schématiquement un « Ouest » élargi à un axe alternatif, tend à rigidifier les relations commerciales. Là où les entreprises cherchaient auparavant le fournisseur le plus compétitif, elles doivent désormais intégrer le risque géopolitique comme une variable centrale de leur équation, ce qui conduit inévitablement à une allocation des ressources moins optimale qu’en situation de libre-échange total.
Le prix de la fragmentation
La recomposition des échanges a un coût macroéconomique non négligeable. Historiquement, la mondialisation a permis, grâce à la spécialisation des pays et aux économies d’échelle, une baisse des prix des biens de consommation et une augmentation de la variété des produits disponibles. En fragmentant le marché mondial, on s’expose mécaniquement à une perte d’efficacité. Les entreprises, contraintes de relocaliser leur production ou de changer de fournisseurs pour des raisons politiques, font face à des coûts de production plus élevés.
Cette hausse se répercute in fine sur les prix, alimentant les pressions inflationnistes, et la production.
Surtout, la fragmentation augmente indirectement les tensions politiques. Deux pays ou blocs dont les économies sont très intégrées ont un coût très élevé à rentrer en crise politique, voire en guerre. Le « doux commerce » agit comme une force de rappel vers plus de mesure. Si le découplage entre blocs persiste, alors le coût économique des tensions entre blocs s’amenuise. Plus de tensions, donc encore plus de découplages, constituent donc d’autant moins de force de rappel.
Découplage ou réorganisation ?
Il convient toutefois de nuancer la réalité de ce découplage. L’exemple des relations sino-américaines est à ce titre éclairant. Si les importations directes des États-Unis en provenance de Chine ont statistiquement baissé ces dernières années, passant de plus de 20 % à environ 14 %, la dépendance économique réelle reste forte. On constate en effet une augmentation concomitante des importations américaines depuis des pays tiers, comme le Vietnam ou le Mexique, qui eux-mêmes ont accru leurs échanges avec la Chine.
Cela suggère, en nuance du découplage, une réorganisation des circuits : les produits chinois continuent d’entrer sur le marché américain, mais après avoir transité ou avoir été assemblés dans des pays « intermédiaires ». Cette persistance des liens indirects montre la difficulté de dénouer des décennies d’intégration économique et souligne que la fragmentation, si elle est bien réelle politiquement, se heurte à la complexité des chaînes de valeur industrielles.