Cette œuvre concentre une réflexion sur les problématiques des dépenses publiques, et aborde des enjeux sociaux, territoriaux, régaliens, écologiques et économiques, permettant d’acquérir une vue d’ensemble du thème, données et graphiques à l’appui.
Le traitement des enjeux économiques et les partis pris de l’essai reflète la pensée de l’auteur, et non celle de La Finance Pour Tous, qui joue le rôle de relais d’un travail riche et densément documenté.
Enjeux des dépenses publiques : un budget équilibré… en théorie ?
Un enjeu majeur réside dans la budgétisation des besoins et des ressources de l’État. Le processus d’élaboration du budget commence en février de l’année précédente avec des conférences techniques, puis se poursuit en avril et mai avec des conférences immobilières et budgétaires.
En juin et juillet, des arbitrages prévisionnels sont réalisés sur la base des éléments fournis par la Direction du Budget.
Entre août et septembre, le ministère de l’Économie et des Finances (Bercy) rédige le Projet de loi de finances pour l’année suivante en concertation avec les différents ministères.
En parallèle, le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale et le Projet de loi de finances rectificative de fin de gestion sont examinés par l’Assemblée nationale et le Sénat en novembre, avant l’adoption définitive d’une loi spéciale en décembre.
Enfin, en janvier, le gouvernement consulte les partis politiques et groupes parlementaires pour préparer le prochain budget.
L’ensemble de ces projets doit être adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat avant d’être promulgués par le Président de la République.
Toutefois, ces dernières années, les débats budgétaires ont mis en évidence la difficulté d’obtenir un consensus au sein de l’hémicycle, entraînant de nombreux blocages.
Face à ces tensions, le gouvernement a régulièrement eu recours à l’article 49.3 de la Constitution, permettant l’adoption du budget sans vote parlementaire, sauf en cas de motion de censure.
Entre mai 2022 et décembre 2023, la Première ministre Élisabeth Borne a utilisé cette procédure à 23 reprises.
Les approches du budget
Il convient de rappeler les trois approches du budget, chacune jouant un rôle clé dans la structuration et la priorisation des dépenses publiques.
Le budget général constitue le socle principal du financement des politiques publiques et des services de l’État, inscrit dans le Projet de loi de finances voté annuellement.
À côté de cela, les budgets annexes permettent de financer certains services publics spécifiques disposant de ressources propres, garantissant ainsi leur autonomie financière sans impacter le cadre budgétaire principal.
Les comptes spéciaux, quant à eux, assurent la gestion de certaines opérations exceptionnelles, notamment des investissements ou des prêts, sans peser directement sur le budget général.
Enfin, le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale, bien qu’indépendant du budget de l’État, constitue un enjeu financier majeur, couvrant des dépenses essentielles comme la santé et les retraites.
L’articulation entre ces différentes composantes budgétaires reflète la nécessité d’un équilibre entre le financement des priorités immédiates et la soutenabilité des finances publiques sur le long terme. C’est dans ce cadre que s’inscrit la question de la hiérarchisation des dépenses, du financement des investissements stratégiques et de la préservation des ressources pour les générations futures.
Merci encore à Antonin Batteur pour cette réflexion qui est au cœur de l’actualité cette semaine !
La semaine prochaine, nous évoquerons l’équation compliquée des recettes et des dépenses dans ce budget.
Vous pouvez télécharger l’intégralité de l’essai en pdf et nous continuons à vous proposer chaque semaine les meilleurs extraits de son analyse.


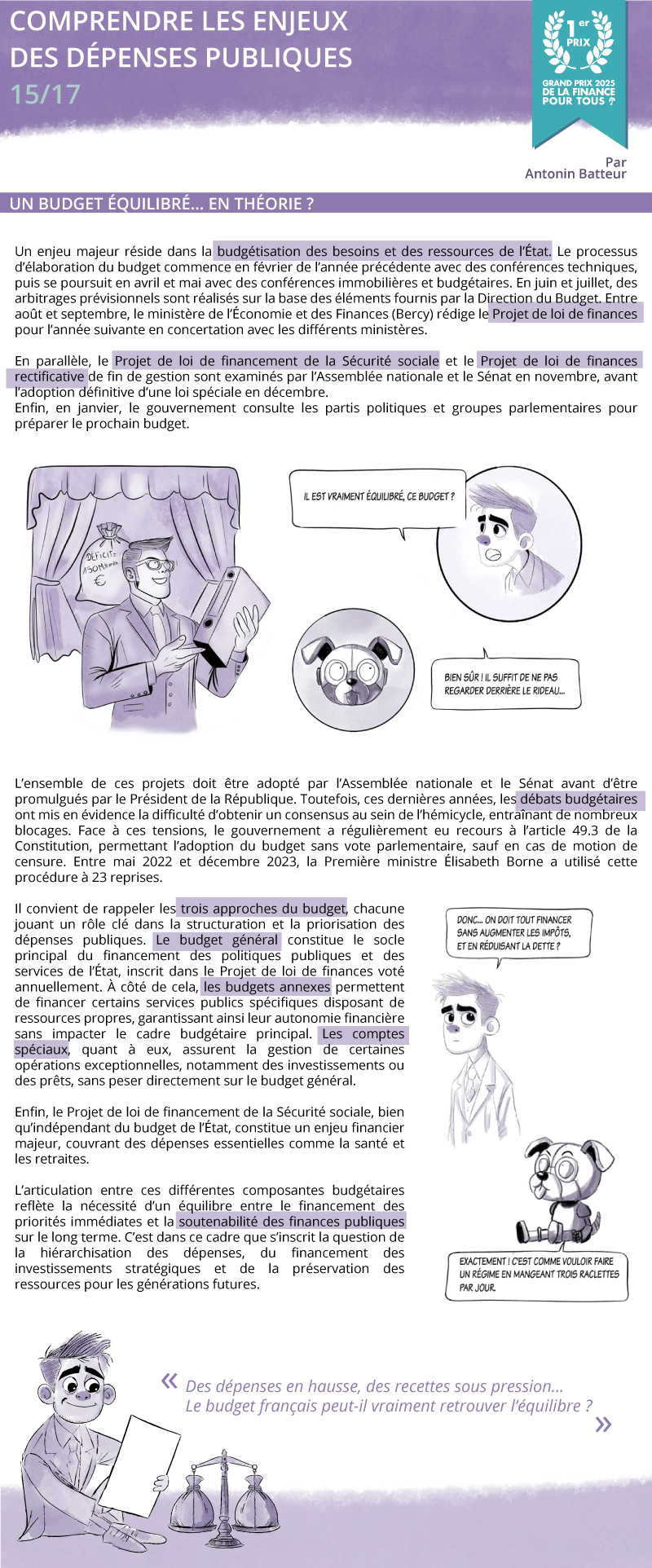
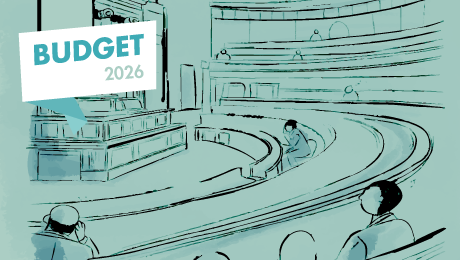
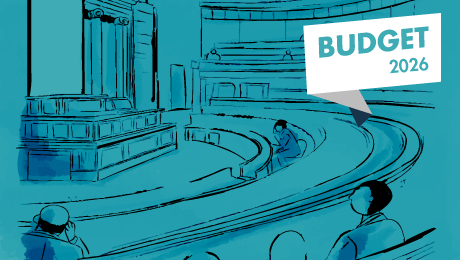

![Enjeux des dépenses publiques [14/17] : sous domination des géants du numérique](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/10/grand_prix_14_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [13/17] : une révolution technique, un retard français ?](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/10/grand_prix_13_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [12/17] : réduire nos émissions… en les exportant ailleurs ?](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/10/grand_prix_12_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [11/17] : artificialisation, pesticides et surpêche : une biodiversité sacrifiée ?](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/09/grand_prix_11_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [10/17] : une armée entre réorganisation et nouvelles menaces](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/09/grand_prix_10_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [9/17] : une fiscalité en mutation entre compétitivité et contraintes](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/09/grand_prix_9_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [8/17] : une démocratie sous pression](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/09/grand_prix_8_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [7/17] : inégalités et fiscalité, un système favorable aux plus aisés ?](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/08/grand_prix7_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [6/17] : précarité et aides sociales, un système sous pression](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/08/grand_prix6_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [5/17] : chômage, un mal français structurel](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/08/grand_prix5_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [4/17] : la crise du logement, une pénurie chronique](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/08/grand_prix4_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [3/17] : l’éducation, un investissement sacrifié ?](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/07/grand_prix3_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [2/17] : vieillissement et migration, un équilibre menacé](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/07/grand_prix2_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
![Enjeux des dépenses publiques [1/17] : défis du système de santé en France](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/07/grand_prix1_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)
