Le PNB, mesure de l’activité bancaire
La mesure la plus précise et commune de l’activité des banques et plus précisément des établissements de crédit est le PNB (produit net bancaire).
|
Activité |
Type de revenu associé |
|
Activité de prêts (moins coût de la ressource) |
Marges d’intérêt |
|
Prestations de services (moyens de paiement, assistance-conseil, services spécialisés, opérations de hors bilan) |
Commissions |
|
Activités de marché et d’investissement |
Intérêts, + values, dividendes, marges de négociation |
Comment se forment les taux d’intérêt ?
Lorsque la banque prête, elle rend un service : celui de mettre immédiatement à disposition une somme d’argent. Le risque est, pour elle, de ne pas récupérer la somme prêtée… Et cela entraîne des coûts. Une fois acquise l’idée qu’il est normal que les banques facturent un certain taux d’intérêt, il est également vrai qu’elles ne sont pas entièrement libres de choisir ce taux d’intérêt. Elles sont limitées par :
-
les réglementations qui influent directement sur leurs coûts (ratios prudentiels) ;
-
le coût auquel elles se procurent leurs ressources (qui est une donnée sur laquelle elles n’ont pas beaucoup de prise) ;
-
les charges qu’elles supportent pour rendre le service ;
-
la concurrence.
Quant au prix du crédit qui vous est fait, consultez notre article sur le coût de l’emprunt qui vous permettra de décrypter ce qu’il y a derrière un TAEG.
Pourquoi les prêts à la consommation sont-ils plus chers que les prêts immobiliers ?
Les prêts à la consommation sont plus chers que les prêts immobiliers car les banques, et surtout les sociétés financières spécialisées qui en octroient une grande partie, utilisent des ressources plus onéreuses et ont des frais plus élevés.
Des ressources plus onéreuses car n’intégrant pas les dépôts (non rémunérés) de la clientèle ni les plans épargne logement.
Surtout, des frais plus élevés :
-
les montants unitaires prêtés sont moins élevés, donc les coûts de gestion unitaires supérieurs
-
pas de garantie « réelle » (alors que les banques prennent systématiquement des hypothèques et/ou des cautions et exigent des assurances dans le cadre des prêts immobiliers)
-
des incidents de remboursement plus fréquents et des pertes définitives plus importantes.
De plus, les marges sont plus fortes que pour les prêts immobiliers, sur lesquels les banques font plus de sacrifice car le prêt immobilier est un moyen de fidéliser la clientèle sur longue période.
Comment choisir entre toutes les offres de services ?
« Trop de choix tue le choix » ? La tarification bancaire, en la matière, est plus que large. Des packages intégrant une offre de services « tout en un », au paiement « à la carte », tout est possible et tous les prix existent ! Dans les faits, tout dépend de l’utilisation moyenne du compte courant et des diverses opérations qui y sont liées.



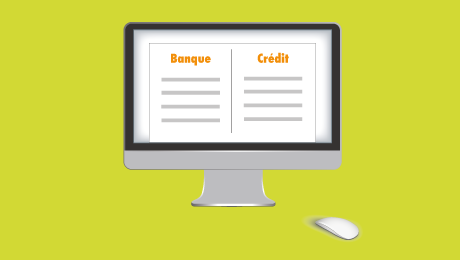
Commenter